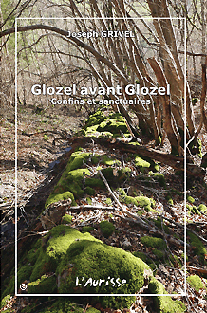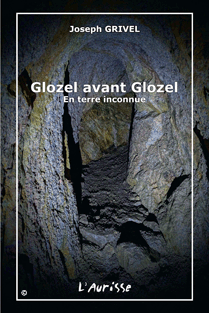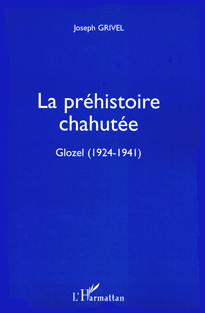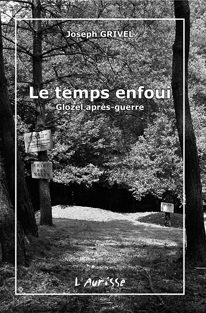Projets
Glozel avant Glozel
Glozel avant Glozel est le titre du deuxième chapitre de Glozel et ma vie, mémoires d’Emile Fradin publiés en 1979. L’emprunt de ce titre est un hommage au seul ouvrage qui ait cherché à replacer Glozel dans un contexte, en évoquant le demi-siècle qui a précédé les premières découvertes. Glozel avant Glozel sera ainsi le titre générique de plusieurs publications visant à rétablir divers contextes locaux à diverses époques, jusqu’aux plus anciennes auxquelles il est permis d’accéder, afin de redonner un cadre hospitalier à Glozel.
Mais comment la surabondante littérature consacrée à ce sujet tant débattu a-t-elle pu l’étudier sans jamais le contextualiser ? Peut-être parce que ces découvertes ont d’emblée été victimes de leur apparente singularité. Un préjugé a fait le reste : cette originalité ne pouvait être d’origine locale. On est donc allé chercher ailleurs sa raison d’être en multipliant les rapprochements avec des découvertes lointaines, sur la base d’analogies fragiles. Mais l’ailleurs ne permet pas mieux d’expliquer Glozel…
Privé de tout ancrage local, écartelé entre des références exotiques peu probantes, cette inclassable collection est ainsi restée une sorte d’émanation de l’absolu. L’insolite s’est engouffré dans la brèche, en sollicitant un ailleurs encore plus lointain. Cette récupération fantastique a servi de prétexte supplémentaire au dénigrement d’un Glozel déjà refoulé depuis longtemps dans les marges de l’archéologie et, de ce fait, livré en pâture aux appropriations les plus hasardeuses.
L’ambition de ce projet est de rechercher les racines locales de Glozel, de restaurer différents environnements sur fond desquels Glozel pourra enfin être mis en perspective et retrouver du sens. Ces travaux sollicitent toutes les disciplines en mesure d’interroger le passé, du plus proche au plus lointain. Un premier ouvrage a été publié dans ce cadre par L’Aurisse en 2019 : Confins et sanctuaires, et un second en 2025 : En terre inconnue. Un troisième est en chantier...
L'affaire de Glozel
Depuis bientôt un siècle, les découvertes de Glozel tiennent la science en échec. Cette résistance insolente, contre laquelle sont venus s’éreinter bien des titres, a fait naître une affaire bruyante rendue aussi complexe par ses développements médiatiques et judiciaires que la question archéologique et épigraphique qui l’a suscitée.
Les publications consacrées au sujet sont innombrables. Aux travaux d’interprétation archéologique et épigraphique se sont ajoutées quelques études historiques et sociologiques. Au point que dresser aujourd’hui une bibliographie exhaustive du sujet est devenu impossible.
Pourtant cette surabondance documentaire ne garantit en rien que la recherche a épuisé la question. Loin de là… Des points de vue n’ont en effet jamais été adoptés, des problématiques jamais formulées. Glozel reste donc, à bien des égards, un dossier à instruire.
C’est ce que fait et continue de faire une étude de l’affaire entreprise il y a plus de trois décennies du point de vue de l’histoire des sciences et de l’épistémologie, angle sous lequel elle n’avait jamais été abordée, alors que ces deux disciplines auraient dû depuis longtemps en faire un cas d’école. Sur près d’un siècle, cette étude couvre toute la controverse, toujours vivace, non seulement dans ses développements scientifiques, mais aussi médiatiques et judiciaires. Elle va en outre rechercher jusqu’au XIXe siècle certains motifs de la querelle.
Deux publications, cumulant près de 1000 pages, rendent compte pour l’heure de cette étude : La préhistoire chahutée publiée en 2003 aux éditions L’Harmattan et Le temps enfoui en 2022 aux éditions L’Aurisse. Hormis quelques incursions dans le siècle précédent, le premier volet aborde la période de 1924, année de la découverte, jusqu’à la promulgation de la loi Carcopino en 1941, initiative du régime de Vichy qui met fin à la libre entreprise des fouilles archéologiques. Le second traite des développements après-guerre, avec en particulier la mise en œuvre des méthodes physiques de datation et l’implication de l’Etat au début des années 80.
Cette minutieuse instruction de l’affaire est fondée uniquement sur des données factuelles toujours prises à la source, dont les deux ouvrages fournissent toutes les références par plus de 3000 notes. Elle s’appuie sur l’abondante littérature qu’a suscité l’affaire et sur la consultation de plusieurs fonds documentaires, inédits pour certains : comme le dépouillement complet des volumineuses archives privées du Musée de Glozel, la consultation des fonds Reinach à Aix-en-Provence et Espérandieu à Avignon ouverts en 2000 selon le vœu des donateurs, deux fonds des Archives départementales de l’Allier, plusieurs fonds privés… soit plus de 25000 documents. Et la rencontre régulière, pendant quinze ans, d’Emile Fradin, découvreur du site, ainsi que des derniers protagonistes de la première heure, tous disparus aujourd'hui.
Table des matières de La préhistoire chahutée : PDF
Quelques échos : PDF